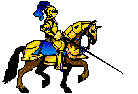| |
 Audinghen
Audinghen
HISTOIRE
|
|
La première mention historique d'Audinghen, est
celle qui se trouve dans la vie de Saint-Bertulphe,
à propos d'un Breton nommé Electus, qui était
venu dérober le corps de ce saint abbé à Boulogne
pour le transporter en Angleterre, et qui l'avait
caché dans 1e village d'Otidigem ou Otidinghem.
Il avait dérobé de même, dans l'église de Montreuil
le corps de saint Gudwal. Arnoul de Flandre, l'ayant
su, envoya l’évêque de Thérouanne Witfrid à la
recherche de ces saintes reliques, puis il les
fit transporter à Gand, pour les y conserver avec
plus de sûreté en 940. Otidinghen serait d’origine
celte et se décomposerait en Otid, nom Celte,
ing, voulant dire fils, et hen pour enclos; c’est-à-dire
l’enclos d’Otig père et fils.
Le nom d'Audinghen se retrouve plus tard dans
la chronique d'Andres, en 1084, avec Guillaume
de Odingehem, cité pour des libéralités qu'il
fit avec ses enfants, en faveur de l'abbaye, dans
la paroisse de Campagne. Cet établissement religieux
possédait, en outre, un moulin dans la paroisse
de Odingahem, dont le donateur, avant 1091, n'est
pas indiqué. Haket de Odinghem ou de Hodingehem,
comparait comme témoin dans deux chartes de la
comtesse Ide de Boulogne, de 1183 et 1186. Il
y a vers le centre du village, au nord-est de
l’église, au lieu nommé le Catelet une motte d'environ
7 mètres de haut sur 100 mètres de circonférence.
Elle n'est point environnée de fossés. Ce doit
être la motte seigneuriale où Haket d'Odinghem
avait son donjon.
En 1224, l'abbaye de Licques y possédait
une dîme, decimam in parochia de Hodingehem, dont
elle jouissait encore en 1790.
En 1226, Pierre de Odingehem, chevalier,
prétendait que l'église d'Audinghen, cela veut
dire le patronage, avec les émoluments du personat,
lui appartenait, à l'encontre de l'évêque de Thérouanne.
Une sentence arbitrale, prononcée le 17 octobre
par les abbés de Notre-Dame de Boulogne, de Samer
et de Saint-Wulmer, prononça que l'église appartenait
à l'évêque. Plus tard, ce patronage échut à Notre
Dame de Boulogne, pour faire de nouveau retour
à l'évêque en 1570. Le chapitre de cette ville
y conserva, jusqu'à la Révolution, des dîmes,
des censives et même quelques fiefs, dont il avait
hérité de la même abbaye, qui y avait des terres
et des hôtes en 1208, et même probablement dès
l'an 1129.
En 1255, l'abbé de Notre-Dame de Boulogne
suppliait le comte de Poitiers, Alphonse de France,
frère de Saint-Louis, de vouloir bien délivrer
à l'abbaye la somme qu'il lui avait promise pour
la fondation d'un cierge. On comptait sur cet
argent pour payer une terre de douze livrées qu'on
venait d'acquérir à Odinguehem.
En 1370 la seigneurie de ce village appartenait
au seigneur d’Odre qui y avait un bailli.
L'église d’Audinghen qui a été détruite sous un
bombardement Anglais en 1943, était un édifice
assez considérable, avec une tour octogonale assise
sur la croisée du chœur et des transepts. C'était
un édifice dont il est difficile de déterminer
le caractère, à cause des nombreuses réparations
qu'à on lui avait fait subir. Il mesurait 43 mètres
de longueur sur 8 mètres de largeur. Les transepts
présentaient un développement de 25 mètres. Dans
une notice publiée en 1839 par la Gazette de Flandre
et d'Artois, M. l'abbé Parenty attribuait au XIVe
siècle la construction de la partie la plus ancienne
de l'église d'Audinghen. Plus tard, le docte antiquaire
s'est ravisé; et une note prise par lui sur les
lieux le 19 septembre 1850, dit que le chœur était
du XVIe siècle mais qu'il y avait quelques traces
du style roman de transition dans l'intérieur
du campanile, au-dessus de la voûte du clocher.
On y remarquait, au dehors, des restes de mâchicoulis.
C'est que cette tour et cette église étaient une
forteresse, dans laquelle la population d'Audinghen
fut prise d'assaut et inhumainement égorgée par
les bandes anglaises qui couraient le pays, durant
les guerres du XVIe siècle. La tradition locale
a gardé le souvenir de cet événement; mais en
voici le récit authentique d'après le manuscrit
n° 52 de la bibliothèque de Lille.
" Les Anglois sont ung jour allet environ deux
mille hommes de pied, et trois ou quatre cent
chevaulx avecq artillerie, assiéget l'église de
Audinghem, en laquelle y avoit environt quatre-vingtz
et huiet hommes boullenisiens, laboureurs et gens
du village, et est entre Boullongne et Callais,
à trois liewes de Boullongnes; ils se sont vaillamment
déffendu plus de six heures, tellement qu'ils
tuèrent ung gentilhomme anglois, et plusieurs
aultres; en la fin, ils se rendirent la vie saulve,
les Anglois les ont pilliés et tous despouilliés,
puis les cappittainnes ont dit : Messieurs, quant
à nous, qui vous avons prins à merchi, nous vous
laissons la vie saulve, mais quant aux gens de
guerre nous en meslons point. Tellement que bruict
court en ceste ville de Saint-Omer, que les piettons
entrèrent dedens icelle église et tuèrent tous
ces povres paisans sans en eschaper un seul; aulcunes
femmes entrèrent par une verrière pensant saulver
leurs maris et enffans, mais autant qu'il y en
entra furent touttes tuées ; quatre prêbstres
estans là dedens, ils leurs coopèrent les doibz
sacrez et les coronnes, puis après les gorges.
La fureur est si grande les ungz contre les aultres
que c'est horreur d'en ouyr parler ". Presque
toutes ces expéditions étaient faites par la garnison
de Guingnes, qui avait ordre de tout tuer, " hommes
femmes enfants; " et dont les soldats prenaient
plaisir à torturer leurs prisonniers en leur tirant
les langues hors des corps, pour les renvoyer
ensuite. Ils avaient pris un jour quatorze femmes
qu’ils avaient tuées à l'exception d'une qui était
enceinte; mais la consigne était .si sévère que
l'Anglais qui se rendit coupable de cet acte d'humanité,
" fut pendu sur le marché de Guingnes ". On
jugera par là du reste.
Le siège de l'église d'Audinghen où furent massacrés
240 habitants, dut avoir lieu au mois de février;
car la lettre du narrateur, qui en parle comme
d'un fait récent, est datée du 7 mars 1543, et
encore faut-il observer que ce chiffre désigne
l'année 1544, parce qu'on était alors avant Pâques.
Ce fut, à n'en pas douter, cette église qui en
fut le théâtre et qui en souffrit les conséquences,
ayant été incendiée en partie et dévastée par
un ennemi sans pudeur (les traces de boulets que
l’on voit encore sur ses restes de mâchicoulis,
indiquent que la tour de cette église dut subir
un bombardement ?). On la répara comme on put;
le peuple était pauvre et le clergé manquait de
ressources. Dans les années qui suivirent, et
presque durant un siècle, la cure d'Audinghen
fut en commende. Le dernier de ses curés commendataires
mérite d'être ici nommé : c'était Noël Gantois
chanoine, archidiacre et grand vicaire de Boulogne.
Plus tard, au XVIIIe siècle, un curé d'Audinghen,
qui était du diocèse d'Amiens et gradué en théologie,
Jacques Ringot, installé le 13 juillet 1730, fut
commissionné doyen du district de Wissant le 19
juin 1740, et devint cure de Samer en 1745.
La seigneurie d'Audinghen appartenait au XVIIIe
siècle à la famille Du Wicquet d'Ordre, qui paraissait
la tenir comme une dépendance directe de la baronnie
de ce nom. C'était le plus beau fleuron de leur
couronne féodale; car aucune paroisse n'était
aussi florissante, à cette époque, sous le rapport
de l'agriculture.
Ce village avait 132 feux en 1789 et il envoya
à l'assemblée électorale de Boulogne deux délégués,
qui furent Antoine Daudruy, et Charles Hamerel.
Ce dernier fut l'un des quatre citoyens que les
électeurs du district de Boulogne envoyèrent le
30 juin 1790 à Arras pour y former avec les élus
des autres districts, l'administration départementale.
Quant à son collègue, il eut un sort bien différent
; car Jean- Jacques Daudruy, son frère, ayant
été arrêté pour avoir dit dans un cabaret " buvons
à la santé de la nation et du Roi, et s'être écrié
deux fois en pleine rue, Vive le Roi" fut guillotiné
à Arras le 29 frimaire an II (19 décembre 1793).
Cette famille Daudruy est connue dans l'histoire
du Boulonnais pour avoir donné à la judicature
plusieurs magistrats et à l'Eglise plusieurs sujets,
entre autres Maxime-Joseph, lié à Boulogne, institué
prieur de Rumilly le 14 septembre 1718, mort prématurément
en 1734.
Au sortir de la tourmente révolutionnaire, Audinghen
se distingua comme centre de la réaction religieuse
dans le Boulonnais. Maître Antoine-Marie Compiègne,
qui y rentra clandestinement la veille de Noël
de l'an 1795, avec le titre de missionnaire, y
exerça clandestinement son ministère pendant la
Terreur. Nommé curé d’Audinghen après le Concordat,
il y fonda, quelques années après, dans les dépendances
du presbytère, un pensionnat dont M. Delrue, réfugié
à Warincthun depuis sa déconvenue de Wimille,
devint le premier professeur. A M. Antoine-Marie
Compiègne, que Mgr de La Tour d'Auvergne appela
à Arras en 1806 pour être le supérieur de son
Grand-séminaire, succéda son cousin, M. Louis-Michel
Compiègne, en qualité tout à la fois de directeur
du pensionnat et de desservant de la paroisse;
puis ce fut son frère, Jacques-Marie-Louis-Jean-Baptiste,
élève du séminaire des Trente-Trois, ancien vicaire
de Saint-Nicolas de Boulogne. Le décret du 15
novembre 1811 sur le régime de l'Université l'ayant
forcé de transférer son pensionnat à Boulogne,
il y mourut le 19 juillet 1816, après l'avoir
remis entre les mains de Mgr Haffreingue.
|