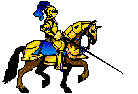| |
 Audinghen
Audinghen
|
|
Audinghen
Village côtier situé à 9 Km au nord-ouest de Marquise,
à 26 kilomètres de Calais et 16 de Boulogne.
Mentionné avant 940 , le nom d'Audinghen serait
dérivé du germanique Aldo haim : établissement
des descendants d'Aldo .
Armes : Parti d’argent et d’or à la croix ancrée
de gueules, chargé au mitant d’une tour d’argent
maçonnée de sable au chef d’azur à trois lions
d’or.
Altitude 0 à 122 mètres.
Superficie : 1309 hect.
Les Audinghinois ou Audinghenois.
|
Année
|
1698
|
1801
|
1841
|
1881
|
1901
|
1939
|
1982
|
1990
|
1999
|
|
Habitants
|
528
|
659
|
807
|
654
|
652
|
527
|
477
|
503
|
548
|
Cette commune est située près du site du Cap Gris-Nez,
point du continent européen le plus proche de
l'Angleterre .
Dans le Boulonnais , il n'y avait que des habitations
éparses et isolées , parce que le terrain , couvert
de bois , hérissé de monticules , entrecoupé de
sources et de ruisseaux , ne permettait point
de former des bourgades . Dans le plus grand nombre
de village , le principal groupe d'habitations
contenait à peu près une douzaine de maisons ,
le reste formait des hameaux en assez grand nombre,
ayant chacun un nom particulier, exprimant quelque
disposition locale ou quelque circonstance relative
à son établissement . Nous avons là cinq hameaux
d'Audinghen . Les suffixes zelle , hen et vert
signifient l'habitation , la ferme , l'établissement.
Audinghen-Floringuezelle
Hameau, désignant la sala, ou sele, c'est à dire
le manoir seigneurial, des nobles Saxons qui l'habitaient
au XIIéme siècle, d'après la chronique
d'Andres, où parmi les noms des vassaux de la
terre de Fiennes, on remarque de 1107 à 1160 ceux
de Florent et de Tibolde de Floringesele, ou Florengeseles.
Vers 1420, Jehan de Habart, mari de Marguerite
de Bournonville, était sieur de Floringuezelle
dont la seigneurie appartint à la famille de Habart
jusqu’en 1550.
Une Calpelle de Floringhezele est mentionnée dans
le terrier de Thérouanne vers l'an 1400. Il n'en
subsiste plus que des ruines près d'une fontaine
dite de Saint-Blaise. On y remarque une motte
de 7 mètres de hauteur sur 100 mètres environ
de circonférence, qui paraît avoir servi à l'assiette
d'un donjon féodal.
C’est à Floringzelle que les Allemands installèrent
leur formidable batterie dite du "Grand-Electeur".
Il y avait là quatre canons de 280 mm, protégés
par un épais blindage d’acier. Les affûts étaient
montés sur pivots bétonnés et pouvaient tourner
à 360°.
Audinghen-Framezelle
Hameau composé d’un groupe de maisons dont quelques
auberges, où se trouve aussi une motte de 11 mètres
de haut sur 120 mètres de circonférence accompagnée
d'un retranchement en forme de croissant sur l'un
de ses cotés, est l'ancien domaine où vivait au
XIIe siècle Raoul de Fiennes, que Lambert d'Ardres
appelle un très pieux serviteur de Dieu.
La chronique d'Andres en parle deux fois, sous
le nom de Flamersele; et cette ancienne forme
du mot se retrouve dans le nom patronymique de
la famille qui hérita de cette terre.
Les chartes d'Artois nous font connaître, en effet,
Thomas de Flameseles, châtelain d'Eperlecques
en 1301.
En 1550, Robert de Framzelle fut emprisonné et
dépouillé de ses biens pour détournement aux dépends
des finances Royales. Le manoir est restitué,
vers 1580, à Adrien de Framzelle qui comparaît
avec la noblesse du Boulonnais en 1588.
Les Manneville achetèrent le manoir en 1689, pour
2700 livres, et le conservèrent jusqu’au XVIIIe
siècle. Il y avait une chapelle de Framezelle,
en titre de bénéfice, sous l'invocation de Saint-Sébastien,
située près de l'ancienne motte, au lieu-dit la
Capelle. Elle était à la nomination de l'abbé
de Beaulieu, ce qui donne à penser qu'elle a été
fondée par les seigneurs de Fiennes. Parmi ses
titulaires, au XVIIIe siècle, on remarque l'abbé
Abot de Bourgneuf (Jean), 22 juin 1704; Joseph
et François de Madot, neveux de l'évêque de Belley
; Nicolas Watteblé, vicaire général de Mgr de
Pressy, etc.
Le chapelain de Framezelle jouissait, pour un
tiers, de la dîme de Rinxent. Dans une cavité
de la falaise a été placée la statue de Notre-Dame
de la mer par la famille Hamain de Framzelle.
Audinghen-Haringuezelle
que la prononciation populaire contracte souvent
en Ringuezelle ou Haringzelle
Hameau situé à l'extrémité du village d'Audinghen,
du côté d'Audresselles, sur le chemin de grande
communication qui relie les uns aux autres, de
Boulogne à Calais, tous les villages de la côte.
Le nom de Haringuezelles apparaît pour la première
fois en 1480, dans le terrier d’Andres. En 1532,
par testament, Loeurens de Campaigne, homme d’armes
sous le duc de Vendosmois, lègue "à ma sœur de
Haringueselle ma cappe, deux jumens qu’y sont
présentement en sa maison, avecq tous mes grains
battus et à battre, à le chergue qu’elle satisfache
et paie une hacquenée à ung curé qu’elle scet".
Jacques Acary, écuyer mort avant 1571 était sieur
de Haringuezelles et de La Rocque. Claude de Roussel
de Pincthun, capitaine des gardes du duc de Chaulnes,
possédait Haringuezelles cent ans plus tard. Ce
fut le fief des familles Coze et De Lattre de
la fin du XVIe siècle jusqu’au XVIIe siècle; des
De Dixmude de Hames et des De Rosny de la fin
du XVIIe siècle au début du XXe siècle, et enfin
de la famille Hamain de Framzelle. Le manoir,
qui datait du XVe siècle a aujourd’hui disparu
au milieu des blockhaus.
Audinghen-Locquinghen
Hameau, où l'abbaye de Notre-Dame possédait une
terre (in Lokingehem), en 1208
Audinghen-Onglevert
anciennement, dans le cartulaire de Notre-Dame,
Hungrevelt (1208), a des homonymes en Alsace où
l'on trouve deux Hungerfeld, et en Brabant où
M. Chotin indique Hongerveld, qu'il interprète
par le champ de la famine. Le carrefour d’Onglevert,
à 86 mètres d’altitude, devaient être un centre
routier important à l’époque Romaine. Il est notamment
traversé par la "voie Romaine de l’Océan" en provenance
de Raventhun et en direction du cap Gris-Nez.
Audinghen-Waringuezelle
Qualifié village dans un acte notarié de 1583.
Anselme de Parenty était seigneur de Waringuezelle,
au XVIIe siècle. Sur le toit de la ferme on voyait
jadis une petite cloche bien décorée de 25 cm
de diamètre, sur laquelle étaient gravés la Ste
Vierge et St Georges. Elle provenait d’un bateau
naufragé au cran de Quette.
Le Grinez, ou Gris Nez
Nom du cap ou promontoire situé au nord du village,
à l'endroit où s'élève aujourd'hui le phare qui
sert à guider les navigateurs. On l'appelle Swartenes,
ou la noire pointe, dans le portulan hollandais
qui porte le titre de Miroir de la mer. Les Français
du XVIIe siècle le désignaient sous le nom de
Blacquenay, ou Blacquenest, avec la même signification,
ce qui a donné lieu à plusieurs de le confondre
avec le Blanc-Nez, son voisin. Les Anglais voulurent
faire du Grinez, pendant l'occupation de Boulogne,
une position stratégique; et à cet effet ils y
construisirent un fort. Le fort de Blaquetz ou
encore Black-Nose était commandé par Sir Richard
Cavendish et comportait 80 hommes de guerre avec
18 pièces de canon et 40 caques de poudre. Le
26 août 1549, Henri II, après avoir repris Ambleteuse,
envoya une compagnie prendre position entre Calais
et le Gris-Nez pour empêcher toute évasion de
la garnison Anglaise qui fut menacée de pendaison
si elle ne se rendait pas sur place. Le mardi
27 août, les Anglais se rendaient, heureux de
s’en sortir "la vye et bagues sauves. On voit
encore les ruines de ce fort, sur la pointe du
Grinez, près du phare. Les Français le gardèrent
quelque temps avant de le démolir; et nous voyons
que " Jehan de Sainte-Marye, capitaine de notre
chasteau et fort de Blacquenay près Ambleteuil,
"reçut du roi, en récompense de ses services,
la jouissance de certain moulin à vent et d'une
brasserie à bière, " scituez au dehors joignant
et contigu le dict fort de Blacquenay que les
Angloix, lorsqu'ils occupaient le dict fort, avoient
fait édiffier (23 juin 1550) ".
|